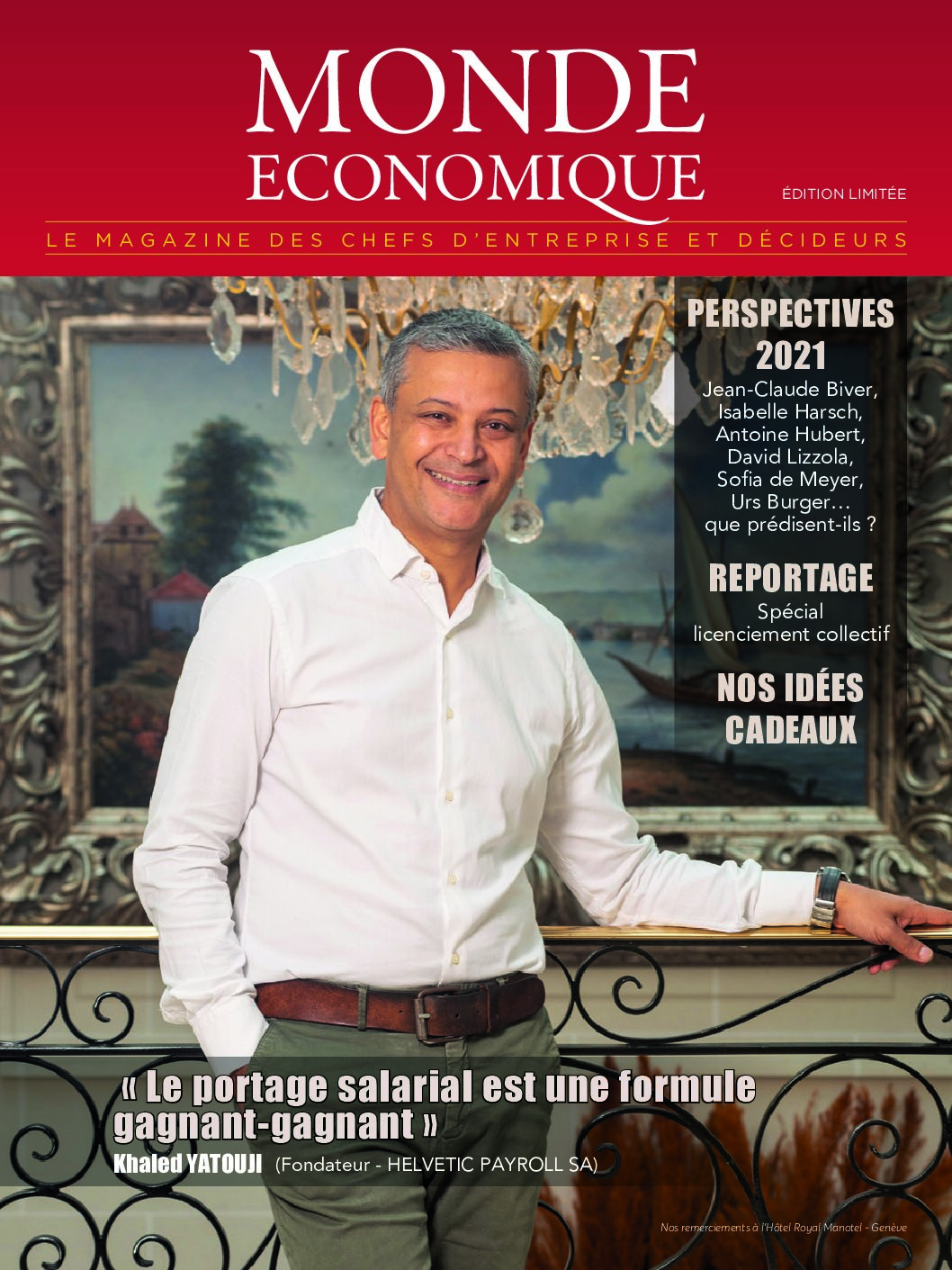DE L’AUTRE COTE DU « ROSZSKE »- GRABEN : UNE INTEGRATION SOCIO- ECONOMIQUE DES MIGRANTS EST-ELLE POSSIBLE EN EUROPE DE L’EST ?
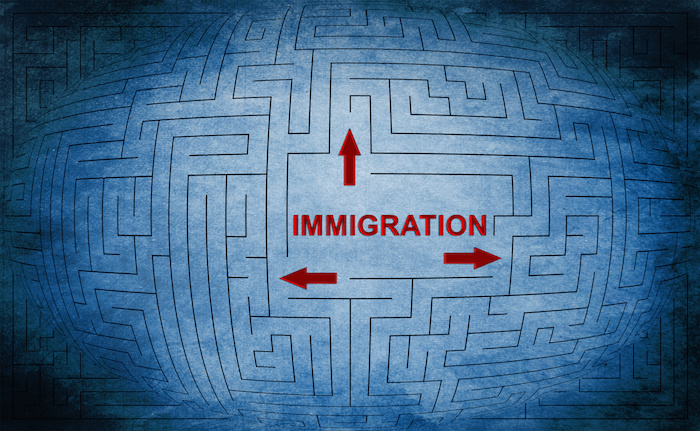
Röszke, le poste de contrôle à la frontière serbo- hongroise, est devenu tristement célèbre ces dernières semaines puisque c’est là où la Hongrie de Victor Horban a décidé de construire un mur anti- migrants et repousser le flux des réfugiés syriens s’avançant vers l’Europe de l’Ouest et du Nord.
Je connais bien le passage à Röszke que je traverse au moins deux fois par an, à la faveur de voyages qui suivent la même trajectoire que celle des migrants. Il m’est d’autant plus pénible maintenant de découvrir que ce qui a toujours été pour moi un voyage plutôt plaisant et intellectuellement enrichissant est devenu un véritable chemin de croix pour des milliers d’autres personnes.
Je n’avais en effet jamais imaginé que le léger mais bien perceptible mépris avec lequel les braves douaniers magyars de Röszke nous traitaient nous, les Européens balkaniques, pouvait céder la place à une vraie inhumanité du moment où des gens du Moyen Orient en détresse, complètement démunis dans leur tentative de fuir la guerre, osent franchir la frontière de la Hongrie. Difficile d’imaginer en effet, sur cette même trajectoire reliant l’Europe de l’Est à l’Europe germanophone, des gens asphyxiés dans des bus, des migrants devenus victimes de leurs passeurs, des « chambres » où l’on meurt étouffé, du gazage, des barbelés, des agissements hygiénistes- policiers de douaniers masqués. Tout cela n’évoque-t-il pas les heures les plus sombres de cette même Europe Centrale et les souvenirs de la dernière grande guerre ?…
Röszke est devenu aujourd’hui une frontière par excellence. Plus qu’une barrière serbo- hongroise, ce poste de contrôle qu’hier encore personne ne connaissait scinde aujourd’hui définitivement l’Europe en deux. C’est le vrai fossé (du mot allemand Graben) entre l’Est et l’Ouest : le « Röszkegraben ». Mais à la différence du « Röstigraben » helvétique, qui sépare la Suisse alémanique et la Suisse romande, n’y a plus grande communication entre les deux parties ainsi séparées de l’Europe. Si l’Occident est enclin à chercher des solutions du problème et des modalités d’accueil des migrants, l’Europe centrale et orientale s’entoure de murs et ne veut rien entendre parler. Ses médias s’emplissent d’interrogations de caractère conspirationniste, les commentaires anti- migratoire en même temps qu’anti- Occident se multiplient.
Au milieu de tant d’émotions et de tant d’idéologie, l’économie ose à peine élever sa voix et dire ses raisons. Pourtant, l’aspect économique de la chose est à son tour et au même titre que les raisons humanitaires, un argument pro- migratoire, tant en Europe Occidentale qu’en Europe orientale. Dans les dernières décennies, celle-ci s’est vue déserter par des centaines de milliers de ses habitants partis en Occident chercher une vie meilleure. Ajoutons à cela un fait peu connu en Occident : le taux de chômage très élevé dans les pays les plus pauvres de l’Europe de l’Est – la Bulgarie et la Roumanie – n’est pas dû uniquement à la cause classique de manque d’un nombre suffisant de places de travail mais aussi à une attitude trop sélective, de la part des chômeurs dans ces pays, du travail proposé. Des préjugés solidement enracinés encore depuis l’époque du communisme, dictent aujourd’hui encore une attitude négativiste à l’égard de certains domaines de l’économie : ainsi, tout ce qui relève du domaine de l’agriculture est déconsidéré et traité d’arriéré et de dégradant. Dégradant aussi – et très « looser », d’après un autre préjugé – la contrainte de vivre à l’intérieur du pays, loin des grandes villes. Ce double mépris de l’agriculture et des territoires provinciaux où elle s’exerce traditionnellement, a fait que des milliers de personnes des Balkans ex- communistes préfèrent être des balayeurs de rues en Occident plutôt que des agriculteurs ou même des instituteurs ou docteurs dans les villages de leurs pays ! Certes, les différences de salaires entre Est et Ouest jouent aussi un grand rôle mais ce n’est pas la seule raison du grand exode de compétences intellectuelles et de main d’œuvre qualifiée qu’une grande partie de la péninsule balkanique connaît depuis la chute du communisme, voilà déjà un quart de siècle de là.
Il y a certainement quelque chose de paradoxal de voir des pays s’étant révélés au cours des décennies comme des sources traditionnelles d’émigration économique devenir, avec la crise au Moyen Orient, de potentielles terres d’accueil pour une émigration de type politique. Et pourtant, cela peut bien se produire. Des réfugiés de guerre venant occuper les places de travail et le territoire laissés par des autochtones partis de leur côté chercher ailleurs de meilleures conditions de vie. Cela peut, effectivement, se produire – non seulement par la contrainte du régime des quotas mais aussi à la faveur d’une meilleure prise de conscience des intérêts et des besoins réciproques et une organisation susceptible de « dispatcher » les nouveaux arrivants vers lieux d’habitation où ils seront vraiment bienvenus et vers les places de travail où ils seront vraiment indispensables.
Des opportunités d’établissement d’émigrants existent, on le voit, même dans les pays les plus pauvres de l’UE. Mais, en dehors de la nécessité d’une bonne organisation, cet éventuel – et pour l’instant tout à fait hypothétique – accueil, exigerait des populations autochtones et de leurs élites politico- médiatiques d’abandonner la xénophobie dont elles ont fait preuve jusqu’alors – une xénophobie d’autant plus virulente qu’elle ait été profondément et durablement inoculée à l’époque communiste, dans les conditions d’isolation de ces peuples tenus dans la méconnaissance la plus complète de l’évolution des réalités du monde.