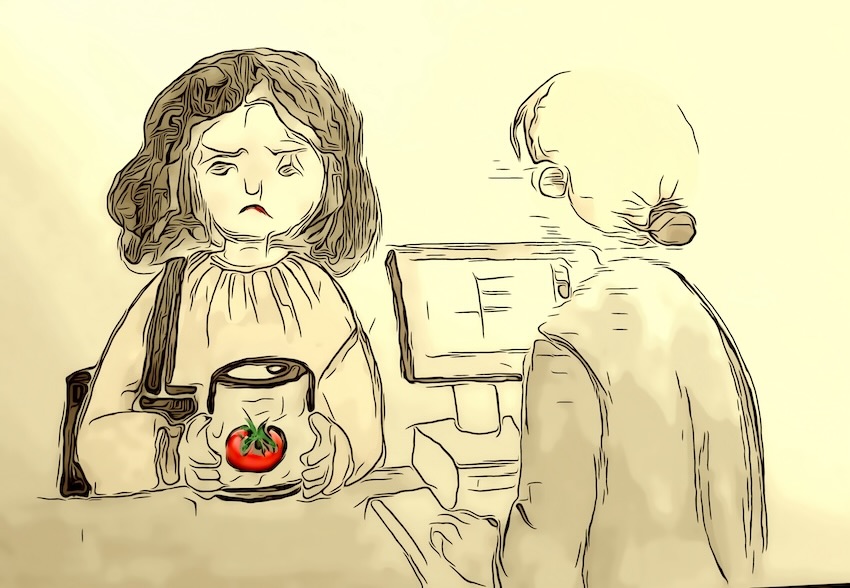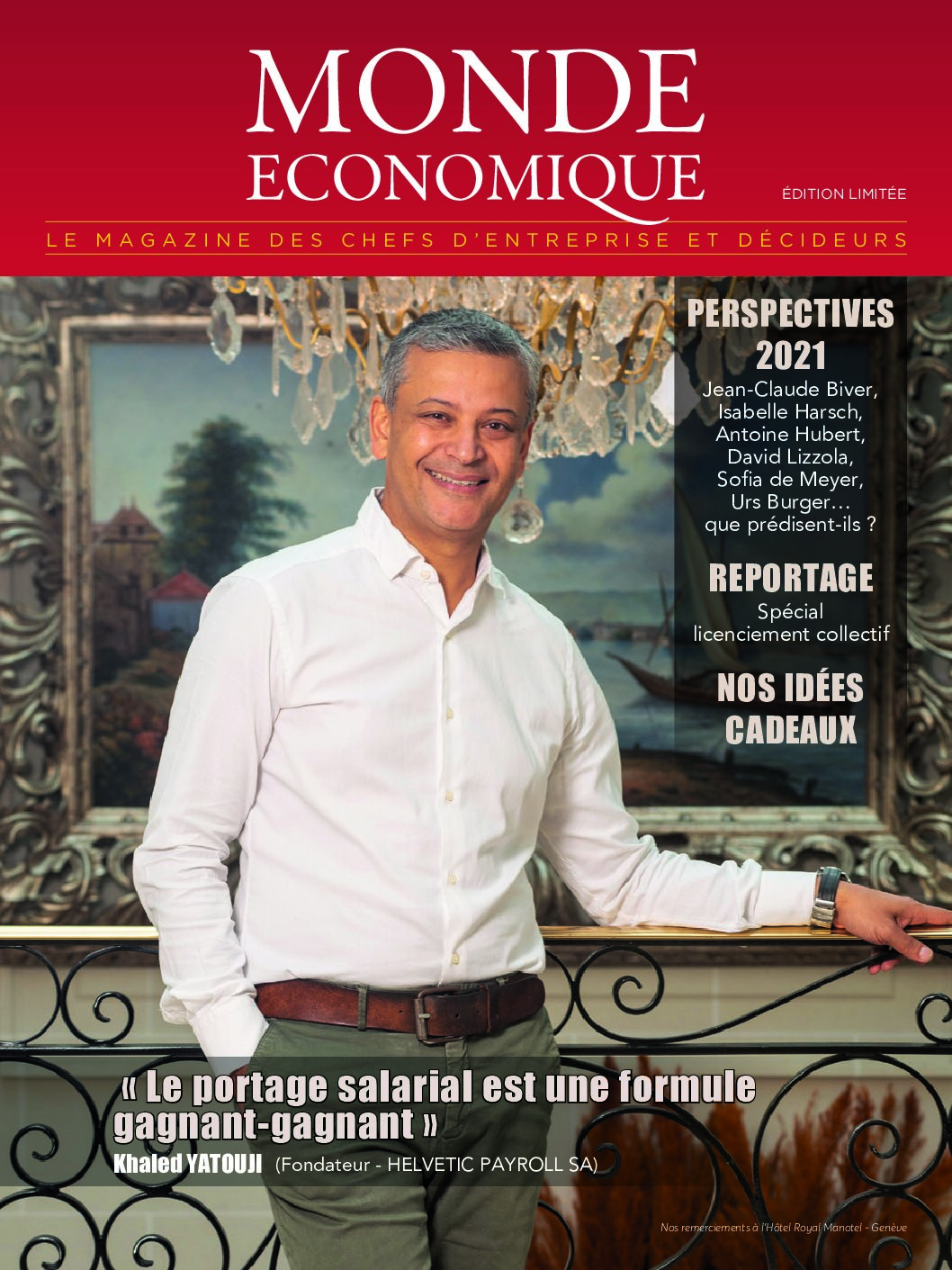L’EUROPE DE L’EST ENTRE REPRISE ECONOMIQUE ET CRISE DES MIGRANTS

On s’accorde, ces derniers mois, à parler de vents favorables qui propulsent en avant les économies des pays de l’Europe de l’Est. En premier lieu, c’est la chute du prix du pétrole, l’effondrement retentissant du prix du baril de 115 USD en 2014 au niveau de 50 USD l’année suivante. Gros consommateurs d’une énergie que jusqu’alors ils payaient assez cher (son importation atteignait 6% du PIB de la Hongrie et de la Bulgarie) les pays de l’Est se retrouvent subitement, et d’une manière complètement inespérée, dans une conjoncture très favorable qui leur donne toutes les chances de renouer avec la croissance.
Rappelons-nous que la graduelle adhésion de ces pays à l’Union Européenne qui s’est échelonnée sur plusieurs années (de 2004 à 2013, la Croatie étant le dernier, en date, pays à devenir membre de l’Union) avait coïncidé avec une période d’impressionnante croissance économique, ce qui, de Vilnius à Zagreb et de Varsovie à Sofia, avait créé – au moins au sein des élites politico- médiatiques – un certain climat d’effervescence et de grands espoirs pour l’avenir. Un avenir qu’on n’imaginait autre que, notamment, « européen ».
La crise de 2008 avait brisé cet élan. Très dépendantes des investissements étrangers directs que la crise en question avait passablement ébranlés, les économies de l’Europe centrale et orientale ont connu une période de plusieurs années d’essoufflement et de ralentissement. Mais aujourd’hui cette période paraît, la chute du prix du pétrole aidant, prendre fin. On prévoit une croissance de la production de 3-4% et tandis que pour les pays les plus avancés de la zone, cette reprise s’accompagne d’une nette baisse de l’inflation et d’un considérable accroissement du pouvoir d’achat et d’épargne des consommateurs.
Pourtant, en même temps que les doux vents orientaux (car c’est la surproduction pétrolière de l’Arabie Saoudite et de l’Irak qui a occasionné la chute du prix du baril) dont on parlait plus haut, du Moyen orient souffle un autre vent sur l’Europe de l’Est– cette fois, c’est un souffle du désert qui amène des milliers de migrants fuyant la guerre et ses terreurs. Favorisés sur le plan économique à cause de la chute du pétrole, les membres balkaniques et centre-européens de l’UE paniquent devant cette deuxième tendance provenant elle aussi du Levant : l’émigration en masse de populations entières de la Syrie et de l’Iraq.
En Occident, on a vite fait de taxer de xénophobes les sociétés de l’Europe orientale. Les choses sont en effet beaucoup plus complexes, les méfiances balkaniques à l’égard de tout massif afflux humain de l’Orient pouvant être expliquées aussi par les siècles de domination ottomane sur ces pays – une domination que l’on n’est les peuples de l’Europe orientale ne sont pas près d’oublier. Certes, il est complètement aberrant et abusif d’assimiler l’actuel triste cortège des réfugiés syriens et iraquiens, eux-mêmes victimes des guerres, avec les ottomans conquérants des siècles passés. Pourtant, complètement traumatisée par les atrocités de ce passé historique, la mémoire collective de Bulgares, Roumains, Serbes, Macédoniens et même Grecs, pousse ces peuples à envisager l’afflux des migrants par le prisme de peurs ataviques et à croire flairer des dangers qui sont parfois imaginaires.
D’autre part, malgré certaines apparences « européennes » qui en effet ne se rapportent qu’aux grandes villes, malgré aussi la nette reprise économique dont nous venons de parler, l’Europe orientale et en particulier sa zone balkanique restent une région assez problématique du point de vue socio-économique. La croissance ne profite pas à tous ; il existe des catégories sociales qui sont systématiquement tenues à l’écart du partage des biens – même aux temps de croissance considérable, comme c’est le cas maintenant. Tel est le cas de la large catégorie des aînés, une véritable réforme des retraites n’ayant finalement pas été faite depuis la chute des régimes communistes. Le taux du chômage reste, d’autre part, très élevé chez les jeunes. C’est cette frustration sociale combinée à celle d’ordre historique que nous avons évoquée plus haut qui font que les populations balkaniques, traditionnellement accueillantes et proverbialement hospitalières, restent – chose certainement très regrettable ! – si peu émues du sort des migrants du Moyen orient, si peu solidaires.
« Solidarité » – voilà un mot qu’on entend décidément très souvent ces derniers temps. L’Europe occidentale reproche à l’Europe centrale et orientale de manquer de solidarité envers les réfugiés de guerre et de rendre tortueuse voire impossible leur « Route des Balkans ». Et vice versa – l’Est, de son côté accuse Bruxelles de ne pas lui venir en aide et d’être incapable de préparer une réponse solidaire et collective de l’ensemble des pays européens à la crise des migrants. En attendant, la situation de ces derniers dans les centres d’accueil et d’hebergement ne cesse de se dégrader…