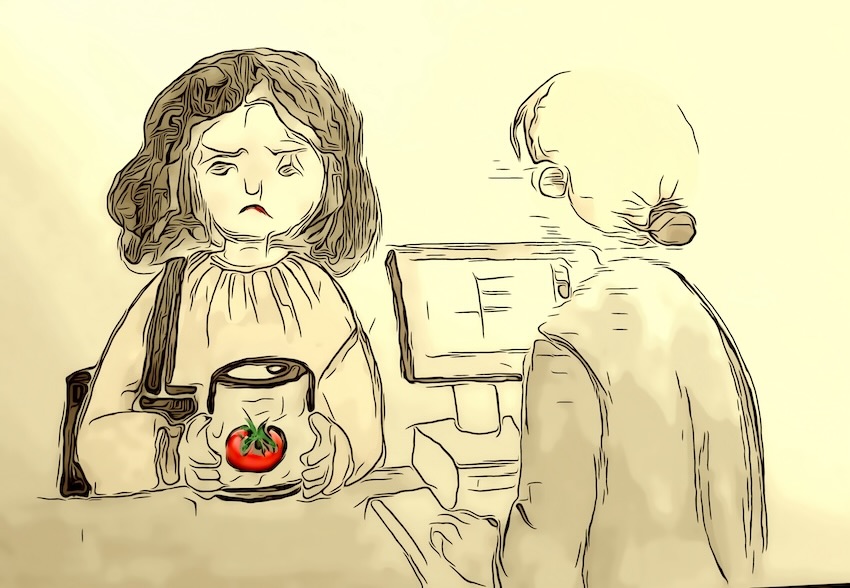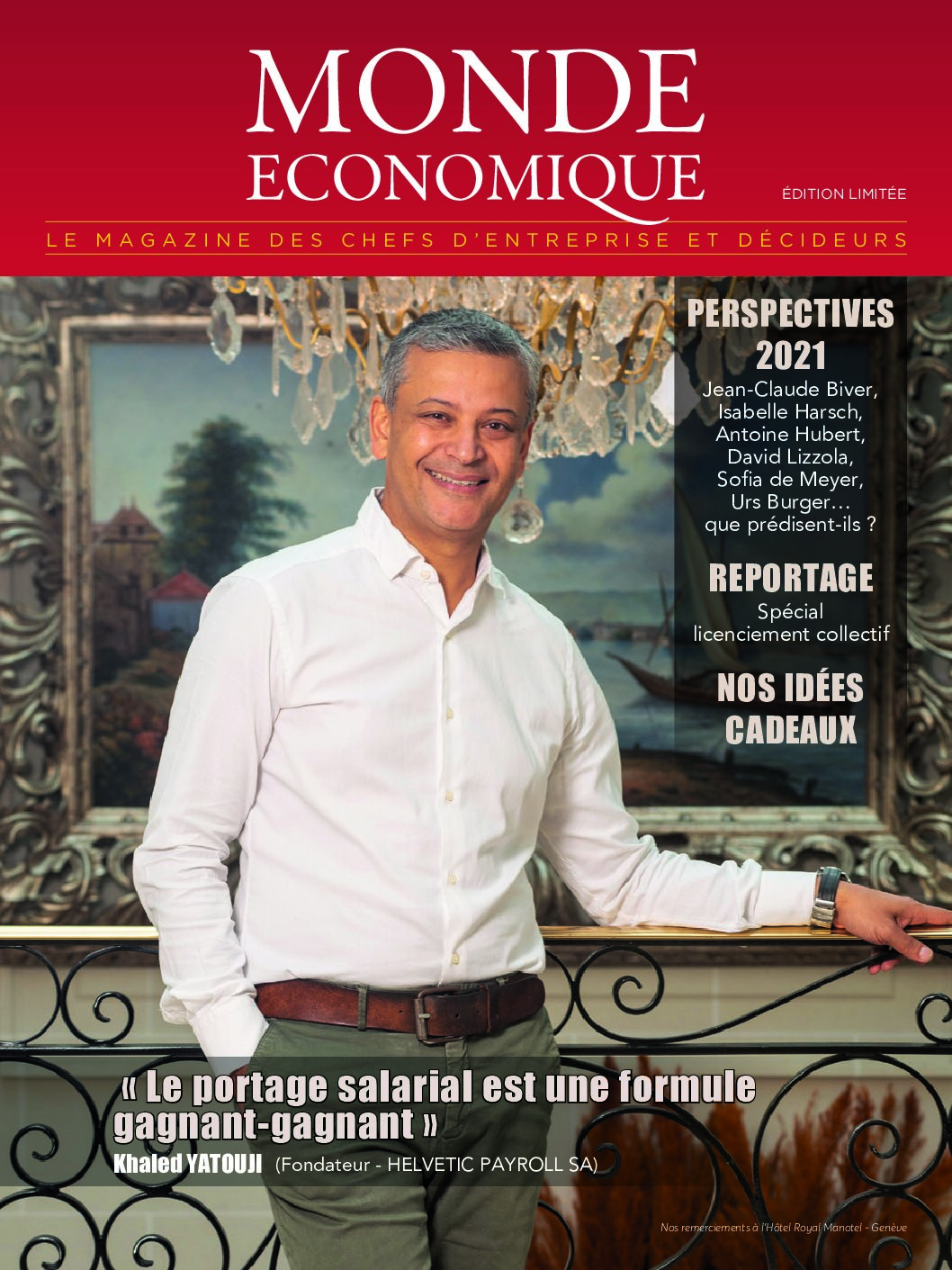BREXIT : L’EURO- PRAGMATISME ECONOMIQUE VA-T-IL FINIR PAR L’EMPORTER ?

On est à moins d’un mois du référendum sur une éventuelle sortie de la Grande Bretagne de l’Union Européenne. Le suspense grandit, la tension monte, les chancelleries d’Etat, les institutions à Bruxelles et, bien sûr, les marchés frémissent à l’attente du résultat du scrutin. La question d’un « Brexit » s’est posée, on se rappelle, vers la fin du premier mandat de David Cameron. Aspirant à sa réélection, le premier ministre conservateur promettait ainsi de répondre au désarroi d’une partie de la population britannique contrainte à faire face à des flux migratoires de plus en plus importants. Des mouvements nationalistes tels que UKIP de Nigel Farage ont su capter ces inquiétudes populaires et l’euroscepticisme diffus de certains des « sujets de sa Majesté » et leur donner une orientation plus clairement indépendantiste et anti- européenne.
Bien évidemment, il n’est pas difficile de deviner, se dissimulant derrière les arguments concrets, un autre facteur, relevant cette fois de la psychologie nationale, et qui sans doute est celui qui pousse le plus décisivement une partie des Britanniques à s’apprêter à créditer le « Leave » le 23 juin prochain. Il s’agit en effet de cette mentalité spécifique qui exalte le Royaume Uni comme un pays extra- européen, une île aux destinées particulières qui, ayant dominé pendant des siècles sur le monde, a aujourd’hui le droit de se réserver une place à part sur la scène internationale. Mais à part l’attachement au crédo de la « singularité britannique », la psychologie nationale anglaise est caractérisée par un autre trait distinctif – le « common sens ». C’est à ce bon sens, à ce pragmatisme foncier, le même qui ensemble avec la passion pour l’innovation avait fait naguère de la Grande Bretagne le premier pays industrialisé au monde, que s’adressent maintenant, d’une même voix, David Cameron, Christine Lagarde, la directrice du FMI, et Jean- Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Ces grands responsables avertissent le Royaume Uni du risque d’isolation politique et économique au sein d’un monde globalisé avec lequel l’« Ile » était jusqu’alors liée par des traités conclus via l’Union Européenne. Une fois l’Union quittée, ces contrats ne seront plus valables pour la Grande Bretagne.
On le voit déjà, la confrontation s’annonce sérieuse, au référendum du 23 juin prochain, entre le bons sens britannique qui chuchote « Remain » et l’orgueil de la « fière Albion » qui martèle : « Leave ». Mais peut-être la question peut se poser autrement. En tout cas, c’est ce que tentent David Cameron et son ministre des finances, essayant de contenter à la fois les nationalistes et les europhiles. Depuis le lancement de l’idée du référendum, le gouvernement ne cesse de vanter les bienfaits d’une sorte d’euro- pragmatisme qui, prévoyant un maintien du « EU membership » du Royaume-Uni, insiste, entre autres, sur le rôle particulier de celui-ci au sein des institutions européennes. Dans cette perspective, la Grande Bretagne aurait une mission de « correctif » politique à jouer auprès des structures communautaires soupçonnées de plus en plus de céder à des tentations anti- démocratiques voire autocratiques. Etat avec les plus longues et solides traditions démocratiques en Europe, le Royaume- Uni peut vraiment être ce membre éclairé, cet observateur vigilant des politiques menées par les institutions, qui saura s’opposer aux tendances de limitation des libertés des Etats et des citoyens européens.
A trois semaines du référendum, cet argument ainsi que l’euro- pragmatisme de Cameron et les avertissements répétés des responsables européens semble convaincre : les sondages font état d’un nombre croissant de Britanniques qui pencheraient vers le « Remain ». Mais au-delà du scrutin dans le pays de « Sa majesté », on peut se demander si l’attitude euro- pragmatique ne sera pas bientôt celle de tous les autres pays membres. La déception de l’Europe institutionnelle a fait remplacer l’europhilie confiante et presque désintéressée du passé par, notamment, un réalisme économique prévoyant et calculateur, voire par un euro- utilitarisme. Va-t-on vers une sorte d’euro- cynisme où l’on profitera à fond des avantages de l’Europe Unie et tout en ignorant et méprisant ses valeurs fondamentales ?…
Quant à l’europhilie, s’il existe encore quelque attachement pour une institution européenne, celle-ci doit être vraiment différente des grandes structures bureaucratiques et technocratiques. Il faut peut-être aller la chercher à Genève, du côté de l’Union Européenne de Radiodiffusion – l’UER qui organise le Concours de l’Eurovision. Sur la scène du « Show favori de l’Europe », c’est non seulement l’europhilie mais une vraie « euro- phorie » qui règne – pour paraphraser le titre d’une des chansons ayant gagné il n’y a pas si longtemps et, d’autre part, pour tenter de décrire avec un seul mot l’incroyable atmosphère d’exaltation et d’optimisme étincelant des dernières éditions du concours.
Mais attention, une telle « euro- phorie » peut nous amener loin des frontières d’une Europe géographique et institutionnelle plutôt morne et désabusée – dans la quasi- asiatique Ukraine (gagnante actuelle et organisatrice de l’Eurovision 2017) ou… même en Australie.