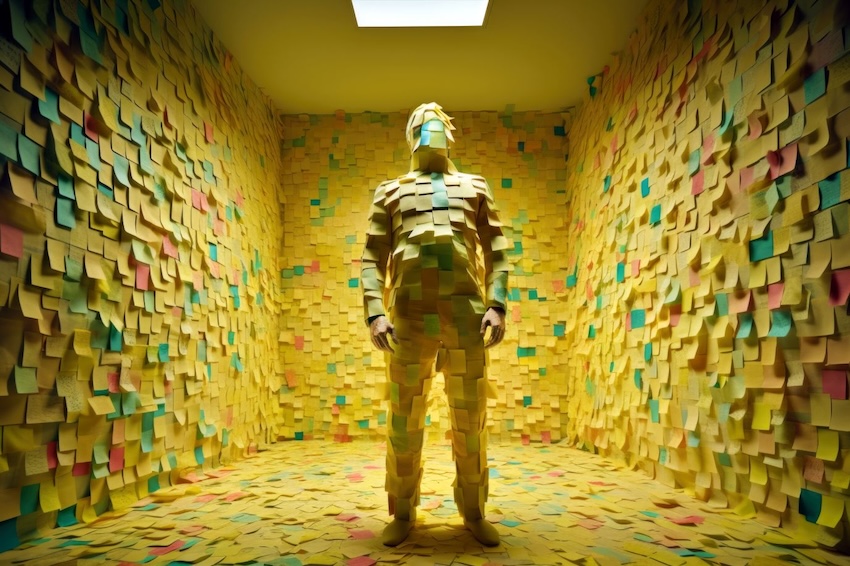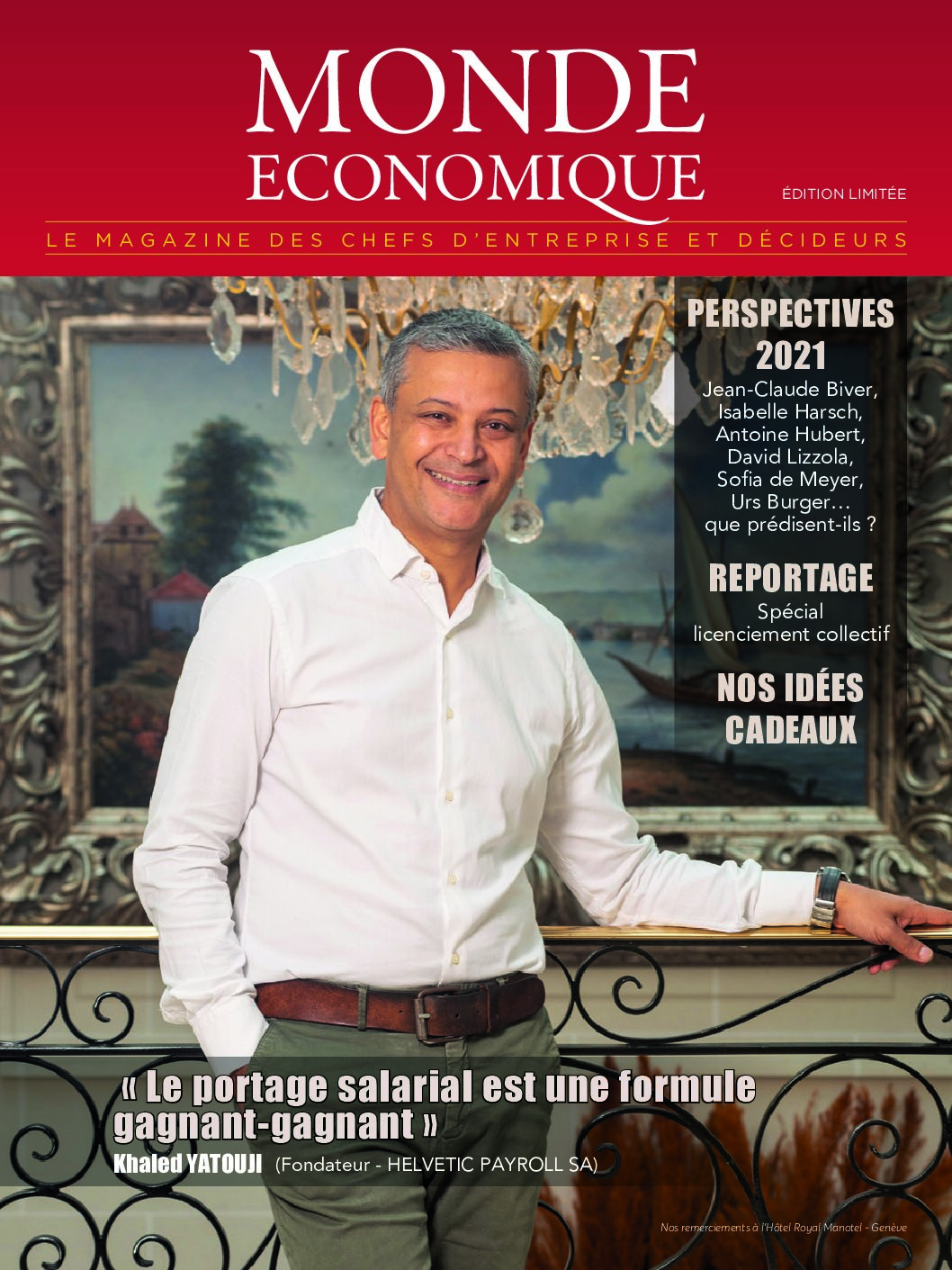Taxes, mensonges et idéaux

Par Michel Saugné, CIO, La Financière de l’Echiquier

Malgré la tempête sur les marchés actions qui a suivi l’annonce de nouvelles taxes douanières le 2 avril dernier, le président américain – dans l’avion qui le conduisait vers l’un de ses terrains de golf – déclarait, radieux : « it’s going very well ».
Certes, le S&P perdait près de 5% le 3 avril, emporté par des chutes d’une rare ampleur, telles que 9% pour Meta, Apple ou Amazon, emportant au total près de 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière en une journée. Mais au moins, assurait Trump, justice serait faite : « l’Amérique » ne se laisserait plus abuser par des pays profitant malicieusement de son excessive largesse. Le commerce extérieur devrait vite se redresser puisque les produits importés du Lesotho par exemple seront taxés à 50%, comme ceux de Saint Pierre et Miquelon ou du Laos. Car la liste des tarifs différenciés va bien jusqu’à ce niveau de finesse dans les pays, jusqu’à mentionner les îles Malouines (3500 habitants, mais bien davantage de manchots !).
Il y a de quoi être décontenancé, mais on peut néanmoins tirer une leçon de ce nouvel épisode, aussi surréaliste soit-il : ce qui compte pour le Président, c’est la posture, non la réalité. La posture est nette : un Président sauve les Etats-Unis d’une situation de soumission aux puissances étrangères malfaisantes. La réalité, c’est qu’il inflige immédiatement aux consommateurs américains une augmentation massive du prix des biens importés, et par contrecoup une baisse probable de la consommation, qui pourrait aller jusqu’à une récession. D’autant que des représailles sont probables, affectant directement les exportations américaines. Le coup de frein serait donc double : sur la consommation et la production.
La réalité économique tellement éloignée des préoccupations présidentielles que la base même du raisonnement sur les droits de douane n’a pas de valeur. Le calcul des droits de douane dits « réciproques » repose en effet sur une formule qu’aucun économiste reconnu ne considère comme appropriée. Elle reflète en effet seulement la proportion entre le déficit commercial américain avec un pays et les échanges de biens totaux avec ce pays, et non une taxation. Implicitement, elle voit dans tout déficit commercial le symptôme d’une taxation insuffisante, alors que les causes du déficit peuvent être multiples, et pas nécessairement problématiques – par exemple lorsqu’un produit ne peut être importé que d’un pays particulier en raison de son expertise ou de son positionnement dans la chaine de valeur. Ainsi, un vin de Bourgogne ne peut être produit ailleurs que sur son terroir. Être déficitaire sur ce type de commerce ne vient pas forcément d’une insuffisante taxation.
Non seulement la formule utilisée par Washington n’a pas de valeur économique, mais en outre elle ignore presque la moitié de l’économie des échanges. En effet, elle n’intègre que les échanges de biens et non de services, alors qu’en ce domaine les Américains sont généralement excédentaires. Si les Européens, déficitaires sur ce plan, appliquaient la formule de Trump aux échanges de services, ils devraient lourdement taxer les revenus générés par exemple de Google, Visa ou Disney. Inspirée indirectement de Trump, l’idée fait son chemin à Bruxelles.
Enfin, c’est la réalité historique des guerres commerciales que Trump n’a pas forcément bien mesurée. Lorsqu’on examine les épisodes de guerre commerciale pratiqués par les Etats-Unis ou d’autres pays – car tous s’y sont adonnés, y compris les pays européens, à un moment ou un autre de leur histoire – on s’aperçoit que ces guerres ont un tel coût en termes de représailles commerciales qu’elles finissent généralement par être abandonnées. Ce fut le cas par exemple de la guerre commerciale défendue par le président McKinley, un idéal auquel se réfère Trump. Président protectionniste de 1897 à 1901, il déclara pourtant dans le dernier discours avant son assassinat : « Les guerres commerciales ne sont pas profitables. Une politique de bonne volonté et de relations commerciales amicales empêchera les représailles. » Souhaitons qu’il ne faille pas attendre le dernier jour de Trump pour qu’il aboutisse à la même conclusion que son idole.
***
Opinion rédigée le 4 avril 2025
Disclaimer : Ces informations, données et opinions de LFDE sont fournies uniquement à titre d’information et, de ce fait, ne constituent ni une offre d’achat ou de vente d’un titre ni un conseil en investissement ni une analyse financière. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Retrouvez l’ensemble de nos articles Economie