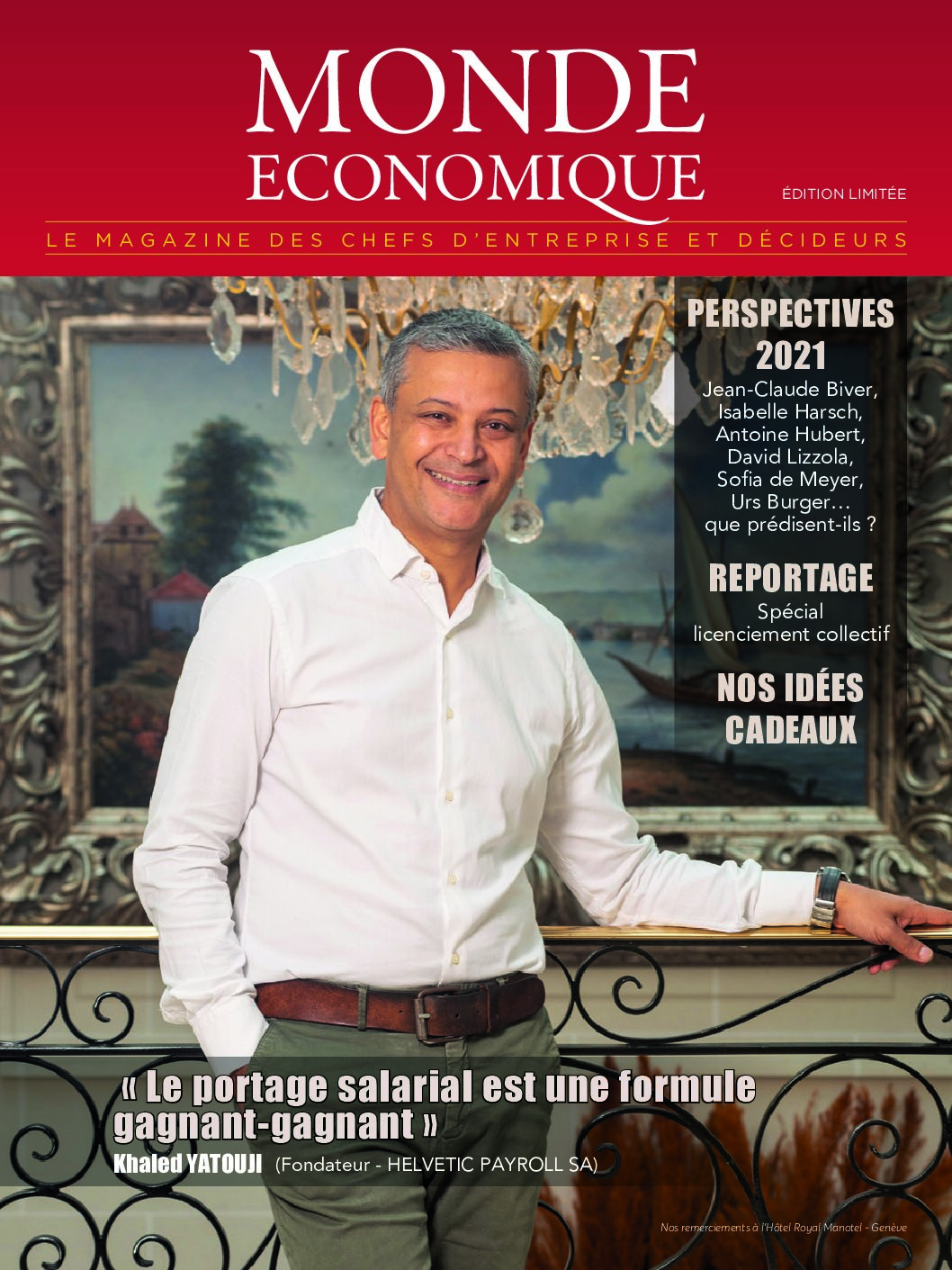Edito de Thierry DIME – Les mots à l’épreuve du temps

Chères lectrices, chers lecteurs,
Récemment, j’ai reçu un courrier qui m’a interpellé. Une dame, poliment et sans agressivité, me reprochait l’utilisation du mot “femme” dans l’un de mes éditos. Elle m’invitait à privilégier le terme “sexe de naissance” afin de ne froisser personne. Ce courrier, bien que dénué de malveillance, m’a laissé pensif et songeur.
Le langage, miroir de notre époque
Derrière ce simple échange, une question plus large se dessine : vivons-nous dans une époque où le souci de ne heurter personne prend le pas sur la spontanéité et la richesse du langage ? Et, plus encore, la dérive de ce qu’on appelle communément le “wokisme” ne pousse-t-elle pas parfois trop loin certaines bonnes intentions ? Le langage est vivant. Il évolue avec nos sociétés, s’adapte à nos valeurs, reflète nos aspirations. Aujourd’hui, les débats autour des mots révèlent une tension sous-jacente entre le besoin de respecter chaque individu dans sa singularité et la crainte de dénaturer ou de figer notre manière de communiquer. Pendant longtemps, certains mots ont été chargés de préjugés et d’exclusions. Les luttes pour l’égalité, qu’il s’agisse de genre, d’ethnicité ou d’orientation sexuelle, ont permis de déconstruire des systèmes de domination ancrés dans la langue. Et c’est une avancée précieuse. Mais en voulant éviter toute offense possible, ne risquons-nous pas de tomber dans un excès inverse : une sorte de police des mots qui inhibe plutôt qu’elle n’enrichit ?
Le terme “sexe de naissance” suggéré par cette lectrice est une tentative de neutralité. Une manière d’inclure les personnes qui ne s’identifient pas au genre qui leur a été assigné à la naissance. Je comprends cette volonté. Mais je m’interroge : en cherchant à être inclusifs, ne risquons-nous pas d’effacer une part de notre identité collective et individuelle ?
Ma réflexion n’est pas une critique des mouvements qui cherchent à rendre notre monde plus juste et respectueux. C’est un appel à l’équilibre. Le progrès social passe par une prise en compte des sensibilités nouvelles, mais il ne doit pas se faire au détriment de la liberté d’expression ou de la richesse de nos interactions humaines. Peut-être est-il temps de réaffirmer que la bienveillance ne se mesure pas seulement à la précision de nos mots, mais aussi à l’intention qui les guide. Plutôt que de voir cette observation de notre lectrice comme une contrainte, je choisis de la considérer comme une invitation. Une invitation à réfléchir, à dialoguer, à mieux comprendre les sensibilités qui nous entourent. Mais aussi à affirmer que l’échange doit rester ouvert, sans crainte de froisser involontairement. Le chemin vers une société plus inclusive ne sera jamais linéaire. Il est ponctué de maladresses, d’ajustements, de prises de conscience. Mais il doit toujours être guidé par une volonté commune de construire, de se rassembler, et non de se diviser.
À travers cet édito, je tiens à remercier cette lectrice pour son retour. Elle m’a offert l’occasion de prendre du recul, de questionner mes certitudes et de réaffirmer mes convictions : les mots comptent, mais ce sont nos intentions et nos actions qui font la différence. Continuons donc à avancer ensemble, dans la bienveillance et dans la positivité. C’est en échangeant, en écoutant et en apprenant les uns des autres que nous trouverons un équilibre, sans pour autant perdre ce qui fait la richesse et la diversité de nos langages.
* * * * * * * * * * *
PS : En tant que journaliste, mes éditos n’ont aucune intention de heurter les sensibilités, mais visent à engager une réflexion constructive et bienveillante sur les nuances des interactions humaines dans un monde en constante évolution.
Retrouvez l’ensemble de nos articles Décryptage