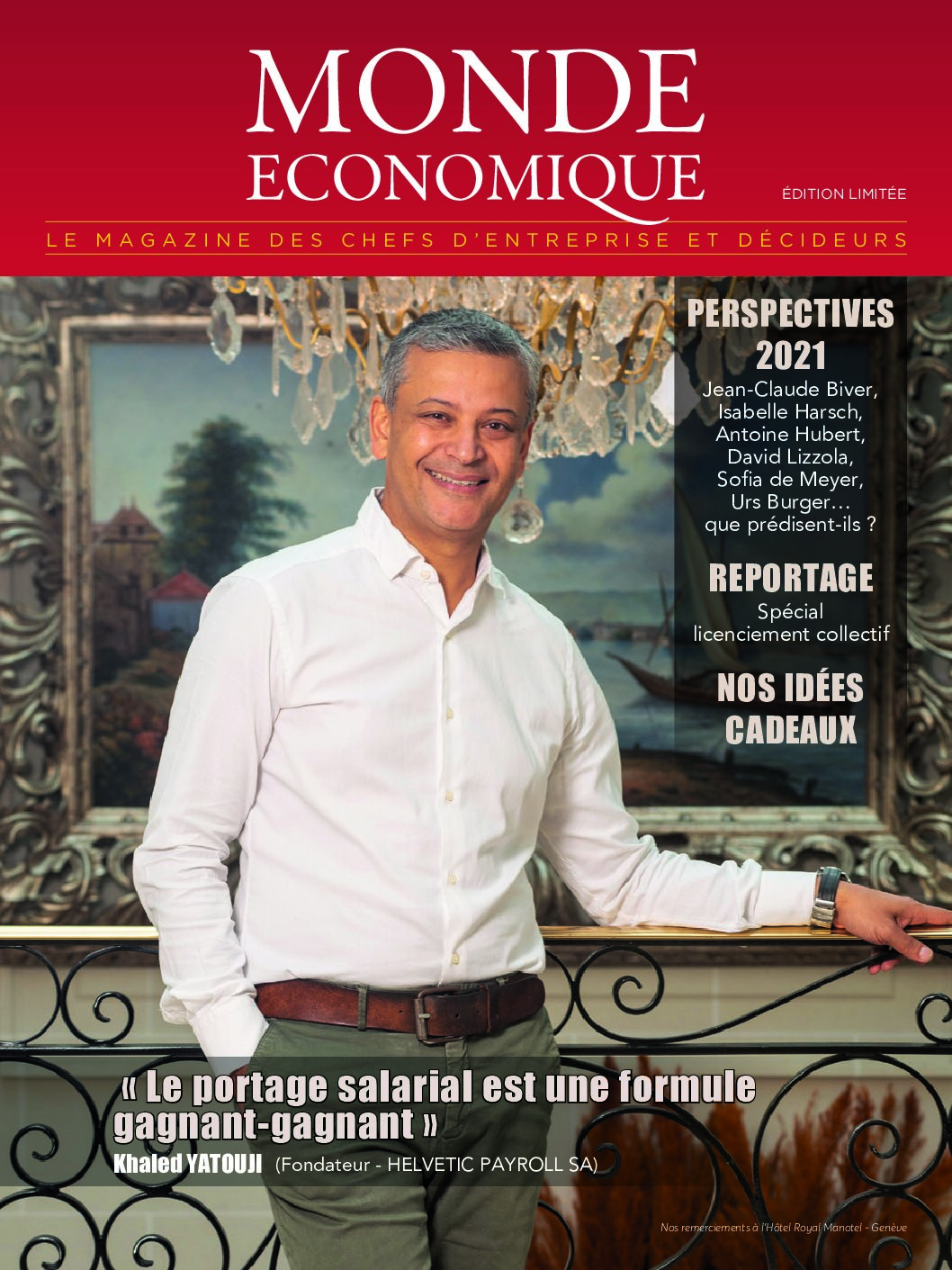IL Y A DIX ANS, LA CRISE…

Les prémices de la crise s’étaient fait sentir encore dès l’été 2007, même si à cette époque, personne ne s’en était vraiment inquiété. Les mauvaises nouvelles liées à des problèmes financiers aggravés et à la situation délicate de quelques banques avaient été accueillies aussi nonchalamment qu’un bref épisode pluvieux au milieu d’un été éclatant de soleil et d’insouciance. Il fallait attendre la rentrée – et encore pas celle qui approchait mais celle de l’année suivante – pour entendre, suite à l’effondrement de la banque Lehman Brothers, le mot fatidique de « crise ». Les causes immédiates de la catastrophe furent tout de suite connues – l’explosion de la bulle immobilière et la dérive des « subprimes », ces emprunts immobiliers américains dont le taux d’intérêt est le plus souvent très bas. Mais les causes plus profondes étaient à chercher plus loin, encore dans les années Reagan.
Des phénomènes qui remontent à la décennie 80.
C’est que, depuis la dérégulation de la sphère financière opérée par Reagan avec la forte participation de Milton Friedman, Prix Nobel d’économie et véritable éminence grise dans la Maison Blanche ces années- là, l’aventurisme bancaire ne connaît pas de contraintes étatiques. Ni éthiques d’ailleurs. Il n’a fait que se renforcer pendant la décennie suivante, ensemble avec l’arrogance de certains milieux financiers conscients de l’immense liberté d’action dont ils bénéficiaient et de leur puissance qui désormais pouvait s’étendre à l’échelle planétaire. De cette arrogance témoigne un article de N. Sarkozy récemment publié dans « Le Monde » où l’ancien président français revient sur l’année 2007 et les premiers signes de la crise: « Certains patrons de la finance se croyaient à la tête d’entreprises plus puissantes que les Etats » – écrit Sarkozy avant de rappeler que «… mais c’est aux Etats qu’ils ont demandé de l’argent pour éviter l’effondrement du système bancaire et, avec lui, de l’économie mondiale ». C’est les Etats et l’économie « réelle » qui devaient subir les conséquences désastreuses de l’endettement que la finance avait si vivement encouragé.
Quelles mesures pour conjurer une nouvelle crise ?
L’impact de la crise était fort pendant les années qui l’ont suivie et des mesures avaient, certes, été prises. La plus importante est le renforcement de la concertation entre les pays du G-20 en matière de commerce international et de coopération économique en général. Des mécanismes furent d’autre part adoptés qui aujourd’hui permettent une meilleure gestion de cas du type « to big to fail » et une prévention efficace des risques liés à la faillite des grandes structures bancaires. D’autre part, la reprise est déjà là, et elle est particulièrement sensible en zone euro où la croissance atteint presque les 2%.
On a pourtant l’impression que c’est là une croissance bien fragile, pour ne pas dire bien frêle. Et cette impression ne vient pas seulement du fait du taux de chômage toujours élevé : elle vient aussi de la conscience d’être en présence d’une croissance piégée, d’une reprise économique qui est déjà minée par les prémices d’une nouvelle crise.
Une croissance piégée.
Les signes, en effet, ne trompent pas. Ils sont facilement reconnaissables car, au fond, il s’agit encore et toujours du même phénomène – l’endettement. La dette est aujourd’hui en voie d’atteindre la valeur colossale de celle dont l’énormité a provoqué l’explosion de la bulle immobilière en 2008. Evaluée à l’échelle mondiale, la dette qui n’a pas cessé de croître après la crise, frôle aujourd’hui les 230% du Produit brut. Aux Etats- Unis d’où le scandale était arrivé il y a dix ans avec, comme prétexte immédiat les emprunts à taux bas, ces derniers sont toujours pratiqués, la seule différence étant dans l’objet de l’achat : aujourd’hui, le crédit est demandé non pas tellement pour des logements mais pour des voitures et …pour études. La dette « académique » atteint 1300 milliards de dollars. La bulle est de nouveau en train d’enfler et la question se pose désormais de savoir non pas si une crise va se déclencher mais quand elle va éclater.
Il y a aussi la question : comment ? Comment se préparer pour affronter le choc ? Les réponses vont des propositions économiques concrètes, comme celle de bannir les mesures d’austérité et de poursuivre la croissance tout en acceptant une dose d’inflation – aux stratégies de type globalistes liées à une réforme ultérieure au sein du G-20. L’ancien président Sarkozy propose par exemple que ce Groupe se charge de la gouvernance économique et financière mondiale en se dotant d’un secrétaire général et en prenant désormais ses résolutions à la majorité et non plus à l’unanimité. Mais cela… ne nous achemine -t-il pas déjà vers une sorte d’autocratie économique mondiale ?